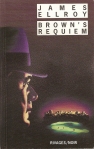Après sa trilogie Underworld USA et son histoire revisitée du pays, James Ellroy revient vers sa ville pour un nouveau quatuor s’y déroulant. Perfidia en est le premier volet, paru en 2014 outre-Atlantique, il nous arrive ces jours-ci, traduit par celui qui a pris la succession de Freddy Michalski pour les œuvres du maître, Jean-Paul Gratias. Le titre reste le même, celui d’un morceau d’Alberto Dominguez, repris par Glenn Miller et son orchestre au début des années 40… Parmi les nombreuses versions de ce morceau, on en trouve une enregistrée récemment pour la série Dexter.
Pour nous aider à patienter, son dernier roman remontant à 2009 aux USA et 2010 chez nous, Ellroy nous avait offert un très court roman, plutôt une novella, intitulé Shakedown chez lui, en 2012, et Extorsion chez nous en 2014. Ellroy y revenait déjà vers sa ville, déjà sous un angle qu’il avait utilisé  pour nous la décrire, sa propension à générer le scandale et à recycler ce côté pervers en richesse. Pour ne pas nous perdre complètement et faire le lien entre la trilogie précédente et le quatuor annoncé, l’écrivain y reprend un personnage croisé dans American Death Trip et Underworld USA. Un personnage réel devenu personnage de roman comme aime à les transformer le romancier. Fred Otash était flic dans les années 50 à Los Angeles, devenu détective privé par la suite, il a surtout utilisé des méthodes plutôt répréhensibles pour glaner des informations sur ses contemporains. Des informations sur ceux qui comptaient dans son coin, principalement les stars hollywoodiennes. Des informations qu’il refourguait ensuite au tabloïds, ceux de son époque. Il est revenu il y a peu dans l’actualité quand furent révélées ses écoutes de Marylin Monroe notamment, il aurait reconnu, dans son journal, l’avoir entendu mourir. Fred Otash est donc un personnage comme les aime Ellroy. Un type sans morale, ou avec une morale plutôt tordue… Dans cette novella, Otash est au purgatoire, espérant pouvoir accéder au nuage supérieur s’il se confie à Ellroy par télépathie. Une demande de ses geôliers, si on peut les appeler ainsi. Alors, il se confie et nous offre quelques histoires croustillantes, mettant en scène Liz Taylor, Kennedy, Jimmy Dean, Liberace, Rock Hudson, Natalie Wood, Ingrid Bergman… Sexe et perversion…
pour nous la décrire, sa propension à générer le scandale et à recycler ce côté pervers en richesse. Pour ne pas nous perdre complètement et faire le lien entre la trilogie précédente et le quatuor annoncé, l’écrivain y reprend un personnage croisé dans American Death Trip et Underworld USA. Un personnage réel devenu personnage de roman comme aime à les transformer le romancier. Fred Otash était flic dans les années 50 à Los Angeles, devenu détective privé par la suite, il a surtout utilisé des méthodes plutôt répréhensibles pour glaner des informations sur ses contemporains. Des informations sur ceux qui comptaient dans son coin, principalement les stars hollywoodiennes. Des informations qu’il refourguait ensuite au tabloïds, ceux de son époque. Il est revenu il y a peu dans l’actualité quand furent révélées ses écoutes de Marylin Monroe notamment, il aurait reconnu, dans son journal, l’avoir entendu mourir. Fred Otash est donc un personnage comme les aime Ellroy. Un type sans morale, ou avec une morale plutôt tordue… Dans cette novella, Otash est au purgatoire, espérant pouvoir accéder au nuage supérieur s’il se confie à Ellroy par télépathie. Une demande de ses geôliers, si on peut les appeler ainsi. Alors, il se confie et nous offre quelques histoires croustillantes, mettant en scène Liz Taylor, Kennedy, Jimmy Dean, Liberace, Rock Hudson, Natalie Wood, Ingrid Bergman… Sexe et perversion…
“La mémoire, c’est une rétrospection revue et corrigée.”
Ellroy nous livre une approche rapide du bonhomme, on imagine ce que cela aurait pu donner sur la longueur, Otash ayant même livré quelques uns de ses secrets dans un livre. On imagine ce qu’Ellroy aurait pu faire de cet homme cherchant à collecter les secrets des uns et des autres pour en vivre… Il a rencontré le bonhomme et nous offre cette courte fiction pour nous appâter, le sujet faisant actuellement l’objet d’un travail pour en tirer une série qui intéresserait Fincher et HBO. Affaire à suivre, donc.
Nous avons patienté, une habitude avec Ellroy, et son nouveau roman arrive.
De retour à Los Angeles, Ellroy s’éloigne de notre époque. Il revient aux sources de la mythologie qu’il a créée, à travers les personnages qu’il a inventés, et dans la ville dont il s’est nourri et dont il a nourri l’histoire. Il revient aux sources de cette mythologie qu’il a créée en convoquant pas mal des protagonistes que nous connaissons pour les avoir croisés dans ses deux séries précédentes, le quatuor de Los Angeles et Underworld USA.
Nous sommes en 1941, les derniers jours de l’année, et les Etats-Unis se préparent à la guerre, les convois militaires traversent la ville pour r ejoindre les endroits stratégiques, les bases le long de l’Atlantique. Les convois militaires traversent la ville et en bouleversent la circulation… et l’actualité. Lorsque l’intrigue débute, deux hommes sont à l’extérieur d’une épicerie et vérifient le bon fonctionnement de l’invention de l’un des deux, un appareil photographique à déclenchement automatique. Ray Pinker et Hideo Ashida ont installé la machine conçue par ce dernier juste à l’extérieur d’un commerce qui a fait l’objet de plusieurs vols récents… Ils l’ont installée pour photographier les plaques minéralogiques des automobiles qui s’arrêtent le long du trottoir. Et ils sont les témoins d’une nouvelle attaque, par un homme seul. Une attaque qui permet de confirmer l’intérêt de l’appareil imaginé par Ashida. Quelques heures plus tard, quatre corps sont découverts, ceux d’une famille japonaise, les Watanabe, dans leur maison. Une famille japonaise éventrée, comme après un seppuku. La communauté japonaise n’est pas en odeur de sainteté, même si les camps s’affrontent, entre partisans et opposants des nazis, de l’empereur et de leurs adversaires, les chinois notamment… La découverte des corps survient à un bien mauvais moment, un moment délicat, étant donné cette guerre en préparation, cette guerre soulignée par la présence des véhicules militaires dans la ville…
ejoindre les endroits stratégiques, les bases le long de l’Atlantique. Les convois militaires traversent la ville et en bouleversent la circulation… et l’actualité. Lorsque l’intrigue débute, deux hommes sont à l’extérieur d’une épicerie et vérifient le bon fonctionnement de l’invention de l’un des deux, un appareil photographique à déclenchement automatique. Ray Pinker et Hideo Ashida ont installé la machine conçue par ce dernier juste à l’extérieur d’un commerce qui a fait l’objet de plusieurs vols récents… Ils l’ont installée pour photographier les plaques minéralogiques des automobiles qui s’arrêtent le long du trottoir. Et ils sont les témoins d’une nouvelle attaque, par un homme seul. Une attaque qui permet de confirmer l’intérêt de l’appareil imaginé par Ashida. Quelques heures plus tard, quatre corps sont découverts, ceux d’une famille japonaise, les Watanabe, dans leur maison. Une famille japonaise éventrée, comme après un seppuku. La communauté japonaise n’est pas en odeur de sainteté, même si les camps s’affrontent, entre partisans et opposants des nazis, de l’empereur et de leurs adversaires, les chinois notamment… La découverte des corps survient à un bien mauvais moment, un moment délicat, étant donné cette guerre en préparation, cette guerre soulignée par la présence des véhicules militaires dans la ville…
Les Etats-Unis préparent la guerre et nous sommes à la veille, littéralement, de Pearl Harbour, le 6 décembre 1941. Quatre protagonistes sont mis en avant, Bill Parker, capitaine de police, Dudley Smith, que l’on ne présente plus, lieutenant de police et déjà pourvus de toutes les “qualités” qu’on lui connaît, Hideo Ashida, scientifique au service de la police, sous les ordres de Ray Pinker, et Kay Lake, jeune femme par qui beaucoup de rebondissements et de questions arrivent… Ce ne sont pas des inconnus, nous les avons déjà croisés, Hideo Ashida, rapidement, dans Le Dahlia Noir, Bill Parker dans L.A. Confidential et White Jazz, Kay Lake dans Le Dahlia Noir et Dudley Smith, dans tout ceux-là et davantage encore, à commencer par Clandestins. Dudley Smith, qui complète, en quelque sorte, le trio habituel. Pas vraiment une promotion, plutôt la confirmation de son importance dans l’œuvre du romancier même si, on s’en souvient, il avait fait parti de ce trio dans White Jazz.
Nous suivons l’histoire à travers ces quatre personnages. Les points de vue n’alternent pas complètement pourtant, en fait de trio, cette trinité chère à Ellroy, trio accompagné de l’habituel Dudley Smith, nous sommes plutôt en présence de deux points de vue, celui de l’écrivain et celui de Kay Lake. L’écrivain racontant à la troisième personne les trois protagonistes masculins et Kay Lake se racontant à la première. Ellroy poursuit en ceci l’évolution qu’il avait amorcée dans son précédent roman, Underworld USA. Il triture encore cette narration qu’il avait installée dans ses romans depuis Le grand nulle part. Il poursuit cette évolution narrative et l’accompagne d’un style plus classique. Le staccato qu’on lui connaissait, ce rythme haché des phrases, laisse la place à une syntaxe plus apaisée. Mais il ne s’agit, bien sûr, que du rythme, les personnages eux sont toujours aussi torturés, à la recherche d’une morale personnelle bien loin de tout consensus.
L’intrigue du roman va en croiser trois, l’enquête autour du quadruple homicide, l’installation de l’état de guerre dans la ville et la chasse à un groupe d’opposants aux idées teintées de rouge. Pas de surprises de ce côté. En arrière plan, les luttes raciales provoquées par la guerre s’invitent, lutte entre chinois et japonais, notamment… Arrière-plan qui est un des propos du roman puisque les quatre parties qui le composent s’intitulent Les japs, Les chinetoques, La cinquième colonne et La chasseresse. Trois intrigues se croisent mais ce qui prend le dessus, ce qui se joue et dévoie la vérité, c’est la lutte de pouvoir entre Parker et Smith. Ce qui se joue, c’est l’appât du gain dont une société comme celle des Etats-Unis ne peut se défaire et la guerre apporte son lot de spéculations, de manœuvres pour transformer en argent les événements. Dudley Smith s’emploie donc à corrompre la vérité, à la déformer, l’inventer au besoin pour que les différents appétits puissent s’assouvir, comme à son habitude.
Il y a la lutte entre chinois et japonais, les chinois voulant se venger de l’histoire récente mais ressemblant tellement à leurs ennemis. Il y a la question des religions et notamment celle de Parker et Smith, tous deux catholiques. Un arbitrage religieux qui n’arrange rien puisque la “reine rouge” de ce volume pratique également la même…
Une intrigue riche, fournie, longue de plus de huit cent pages. Une intrigue qui fait la part belle à l’univers de l’écrivain, y invitant Bette Davis et d’autres, mais créant également des liens entre personnages fictifs et réels, des liens de plus en plus intimes…
C’est un roman énorme d’Ellroy, un roman qui peut parfois frôler le trop-plein, nous étouffer, mais qui finit par retrouver, par moments, un rythme plus habituel chez l’auteur, ce rythme syncopé si remarquable. Une fois que les personnages se sont bien enfoncés dans leurs différents travers, alcool, drogue, sexe, politique et volonté de survivre malgré tout. Tout y est. Même l’absence de réel dénouement, l’impossibilité de décider qui a véritablement gagné.
Au final, on a lu, essoufflés, un roman qui ne dépare pas dans la bibliographie de l’auteur, un roman qui m’a moins emporté que les précédents, moins bousculé, l’habitude peut-être. Un roman plus politiquement correct puisqu’il donne la parole à une femme et à un japonais, victime désignée du racisme ordinaire, exacerbé par le conflit en cours. Mais un roman qui peut se révéler, pour les aficionados de l’écrivain, passionnant par bien des aspects, pour voir éclore les duo ou trio des autres opus du romancier, Blanchard et Bleichert, Buzz Meeks et Ellis Loew, Ward Littell et Scotty Bennett ; pour voir comment la guerre, en quelques jours, peut transformer une ville et des hommes, comment elle peut les amener en un temps record, quelques semaines, à ce qu’ils seront le conflit terminé.
Une fois le livre refermé, on se dit qu’il va falloir prendre son mal en patience pour que le deuxième opus de ce nouveau quatuor ne paraisse, en espérant que les années ne seront pas trop nombreuses…
 zinc. Maintenant, il est dans la cité des anges et la nuit tombe. Alors qu’il se laisse aller dans ce coin qu’il ne connaissait pas, un bus passe et répend sa nuisance sonore. Une femme en descend. Il décide de la suivre. Dans ces rues sombres, à peine éclairées par quelques lampadaires, la femme avance. Un peu plus loin, un autre bus s’arrête et comme, après avoir joué à faire peur à celle qu’il suit, il n’a aucune raison de continuer sa filature, il monte dedans, sans savoir où il va.
zinc. Maintenant, il est dans la cité des anges et la nuit tombe. Alors qu’il se laisse aller dans ce coin qu’il ne connaissait pas, un bus passe et répend sa nuisance sonore. Une femme en descend. Il décide de la suivre. Dans ces rues sombres, à peine éclairées par quelques lampadaires, la femme avance. Un peu plus loin, un autre bus s’arrête et comme, après avoir joué à faire peur à celle qu’il suit, il n’a aucune raison de continuer sa filature, il monte dedans, sans savoir où il va.
 renommée qu’il jalouse tant chez les autres. Il est seul dans le bungalow de Mona qui vient d’être condamnée à une peine de prison pour avoir trop vertement réagi à la condamnation de Dorothy, l’une de leurs voisines, pour vol. Une victime de miroir aux alouettes qu’est Hollywood pour Mona, cette citée tant vantée dans les magazines de cinéma.
renommée qu’il jalouse tant chez les autres. Il est seul dans le bungalow de Mona qui vient d’être condamnée à une peine de prison pour avoir trop vertement réagi à la condamnation de Dorothy, l’une de leurs voisines, pour vol. Une victime de miroir aux alouettes qu’est Hollywood pour Mona, cette citée tant vantée dans les magazines de cinéma. rencontre et ce qui a mené à l’issue fatale.
rencontre et ce qui a mené à l’issue fatale.